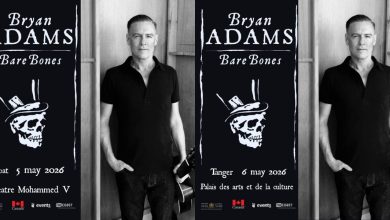Hamid Bénani: « J’ai dû sacrifier le quart de mon scénario »

Le réalisateur du film L’Enfant Cheikh qui est actuellement en salle, revient sur les difficultés qu’il a rencontrées pour produire son film et sur ses motivations. Entretien.
Vous avez réalisé L’Enfant Cheikh, en 2011, avec une distribution prestigieuse. Pour quelles raisons le film ne sort-il, dans les salles marocaines, qu’aujourd’hui ?
À la demande pressante du directeur du CCM de l’époque, je me devais de présenter le film au Festival National de Tanger alors que la post-production du film était loin d’être achevée. J’ai donc dû présenter le film en DVD seulement. Malgré cela, le film a eu un bel accueil auprès du public du festival qui l’a applaudi à deux reprises dont une debout. Et le film a obtenu le prix de la meilleure image.
Les multiples difficultés, en particulier financières, ont fait que le film ne sort qu’aujourd’hui.
Le budget du film semble colossal. Avez-vous bénéficié d’une avance sur recettes ?
Au contraire, le budget est trop chiche. C’est une épopée historique, dont le budget estimatif au départ était évalué, par les professionnels de la production que j’ai consultés à l’époque, à 40 millions de dirhams. Mais, je n’ai présenté qu’un budget réduit à 15 millions de dirhams. L’avance sur recettes qui m’a été accordée est de 5,5 millions seulement. Le président de la commission d’attribution de l’époque, Monsieur Boukous, recteur de l’IRCAM, était prêt, à ma demande, à me doubler l’avance, car il estimait le scénario d’une très grande qualité. Mais le directeur du CCM n’était pas d’accord, alors qu’aucun texte réglementaire ne l’interdisait.
J’ai donc dû sacrifier le quart de mon scénario, et boucler mon récit en recourant aux documents d’archives pour les scènes de pénétration militaire.
J’ai eu la chance de bénéficier de la généreuse aide financière de Madame Wafaa Elachchabi que je remercie ici chaleureusement. Je remercie aussi Monsieur Khalid Snoussi, mon associé dans la société productrice « LE RAMEAU D’OR » pour sa judicieuse collaboration et pour les sacrifices qu’il a consentis pour que mon film voie enfin le jour.
Vous êtes aussi le scénariste du film. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cet épisode de l’histoire coloniale marocaine ?
Pour un marocain de ma génération, l’époque coloniale a été douloureusement vécue. Son souvenir ne peut pas s’effacer.
Mais je me suis particulièrement intéressé à cette période précise lors d’un voyage que j’avais fait avec Abdallah Hammoudi, un ami socio-ethnologue, qui m’avait encouragé à l’accompagner avec un géographe de sa connaissance. De là est née l’idée de faire un film sur la légendaire résistance des Aït Atta.
Comme dans votre premier film, qui reste l’un des chefs-d’œuvre du cinéma marocain, Wechma, le protagoniste est un enfant prénommé Ydir, fils du Cheikh de la tribu, porte-drapeau de la Confédération des tribus Aït Atta, qui sera assassiné. Pour quelles raisons avoir choisi de mettre en valeur ce personnage qui restera muet, tout au long du film ? De façon générale, pourquoi accordez-vous, dans vos films, une place prépondérante à l’enfance ?
Pour recourir à une image facile, on peut dire que l’enfance c’est la racine de l’arbre-homme. L’enfance est une phase capitale de la vie de l’homme. On doit à la psychanalyse et en particulier à Freud d’avoir mis en évidence l’importance capitale de l’enfance.
Pour ma part, j’ai gardé un souvenir intense de mon enfance. J’étais enfant unique de ma mère qui me couvait et me protégeait, à tel point que parfois, dans la grande maison à Meknès où j’ai vécu longtemps seul avec elle, après la mort de mon père, elle m’attachait à la grille d’une fenêtre avec une corde juste suffisamment longue pour que je ne dépasse pas la porte et m’égare dans la rue. Elle réinstallait en quelque sorte le cordon ombilical !
Le silence de l’enfant dans Wechma et dans L’Enfant-Cheikh n’est pas n’importe quel silence, il est lourd de signification, « un silence éloquent ». Un silence qui juge le monde, gros de révolte. Ce n’est pas un silence passif.
Les véritables héroïnes du film restent les femmes que vous présentez comme de véritables amazones, prêtes à occuper la place laissée vacante par les hommes, dont la plupart sont assassinés par les colons français. Peut-on aller jusqu’à dire que vous décrivez une société matriarcale ?
Dans le sud du Maroc et le Sahara, le matriarcat était la structure dominante de la société. Le concept d’amazone est une invention de fiction. Mais le fait est réel, la tribu des Aït-Ouazik était une superclasse prééminente de porte-drapeau, toujours en tête et à la pointe des combats. Cette tribu avait perdu au combat tous ses hommes, il ne restait plus que cet enfant qu’elles élisent leur cheikh en souvenir d’une vieille prédiction, un mythe ancestral.
L’Enfant Cheikhest ponctué d’images d’archives relatives à la résistance de tribus berbères face à l’invasion française. Pourquoi ce choix qui contraste fortement avec une photographie qui rappelle parfois, dans votre film, l’univers orientaliste ?
J’ai expliqué plus haut le pourquoi des images d’archives, ce n’était pas un choix, mais une nécessité. J’aurais bien aimé m’en passer…
J’avoue, je ne sais pas ce que cela signifie votre expression « univers orientaliste ». J’ai fait une image qui rend le plus fidèlement possible l’esthétique de l’époque et de la région. Ne sommes-nous pas l’orient d’extrême-ouest ?
La narration du film est assurée par un conteur qui n’est autre que le héros Saïd, devenu vieux et aveugle, racontant l’épopée des Aït Atta à son petit-neveu. Ce personnage n’est pas sans rappeler la figure d’Œdipe à laquelle votre premier film Wechma se référait déjà. Que représente pour vous le personnage de Saïd et de façon plus générale, quelle signification accorder au mutisme d’Ydir et à l’aveuglement du conteur ?
Les mythes et la dramaturgie grecs sont universels. Ils ont marqué la culture et la civilisation occidentales, et notamment le théâtre et la fiction. Freud et la psychanalyse ont notamment redécouvert l’importance du mythe d’Œdipe dans la psychologie humaine. Chez les Aït-Atta, il y a une pratique permissive qui n’existe nulle part ailleurs : le concubinage et le mariage avec un homme, quel que soit son âge, adopté dans la famille, sont permis (par la Jemaâ) à la femme chef de tente, après la mort de son mari. C’est une des choses qui m’a beaucoup intéressé dans la culture Aït-Atta. Ne sommes-nous pas là en pleine situation œdipienne ?
Vous venez d’écrire un roman à partir de votre film, qui sortira en novembre prochain. Pouvez-vous nous expliquer les raisons d’une telle transposition qui va à rebours des habituelles adaptations cinématographiques d’œuvres littéraires ?
Il n’y a pas de règle de conduite en matière de création. Il se trouve qu’en faisant ce voyage au Saghro, j’étais à la recherche d’un sujet de film, du fait de mon métier. Mais au fur et à mesure de l’approfondissement de mes recherches et de la profonde empathie avec cette culture, et surtout après le tournage de mon film, j’ai senti naître en moi le désir d’écrire un roman. Il faut avouer qu’il m’a largement compensé des frustrations qu’a pu créer en moi le film.
Propos recueillis par Olivier Rachet